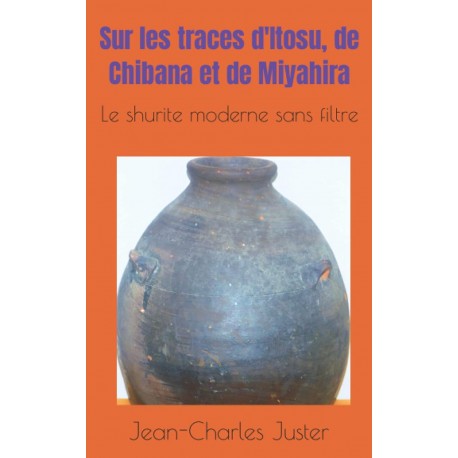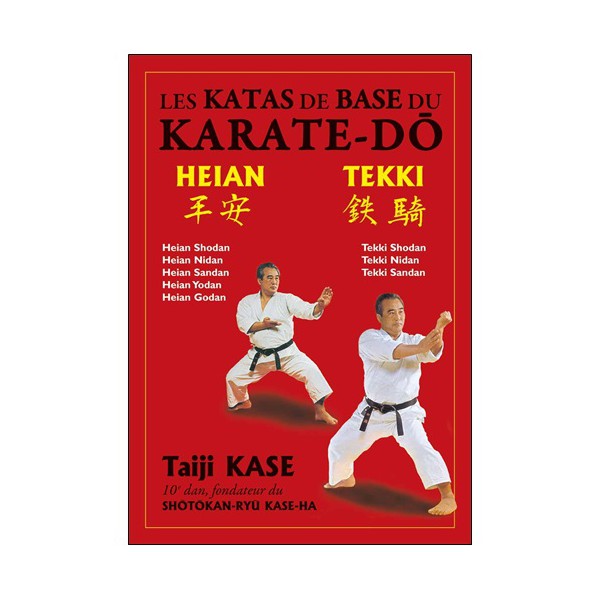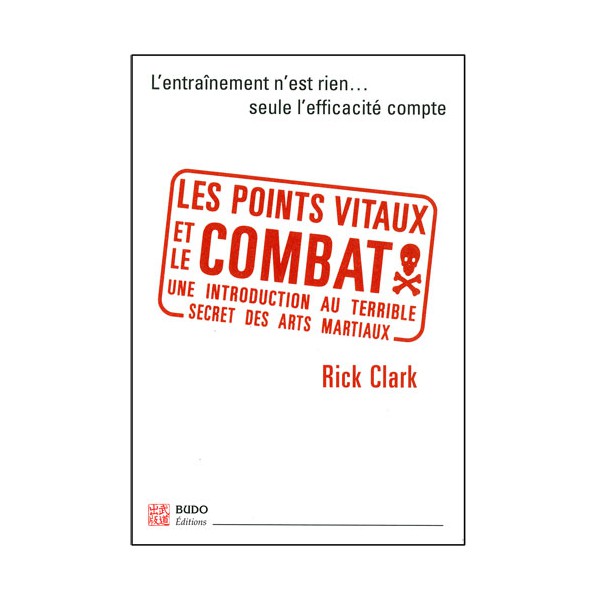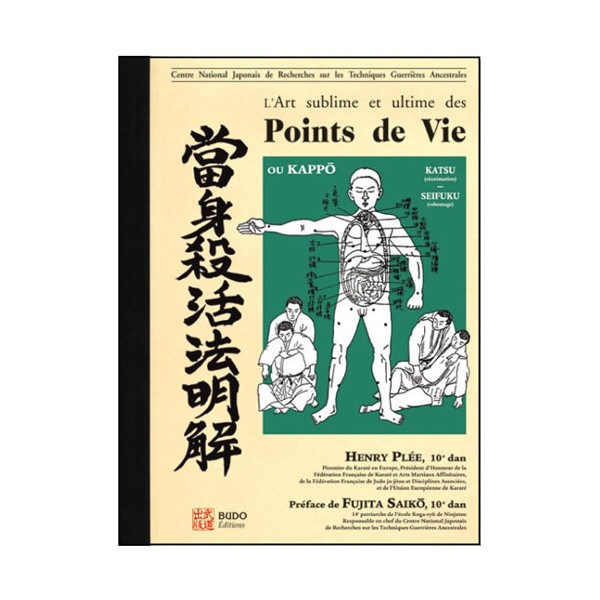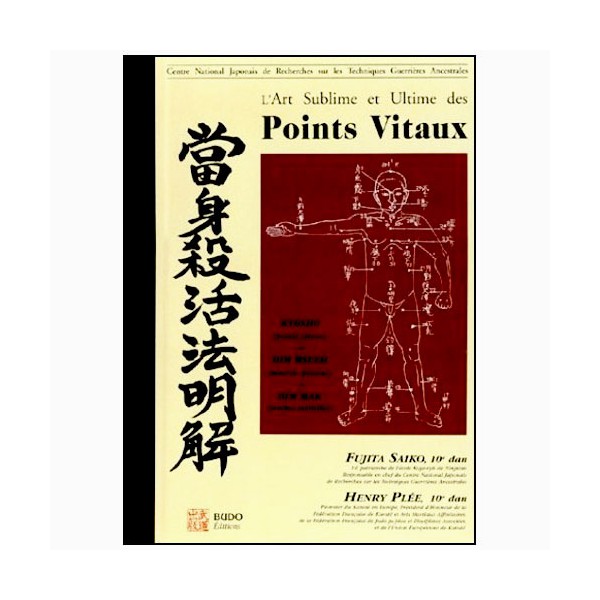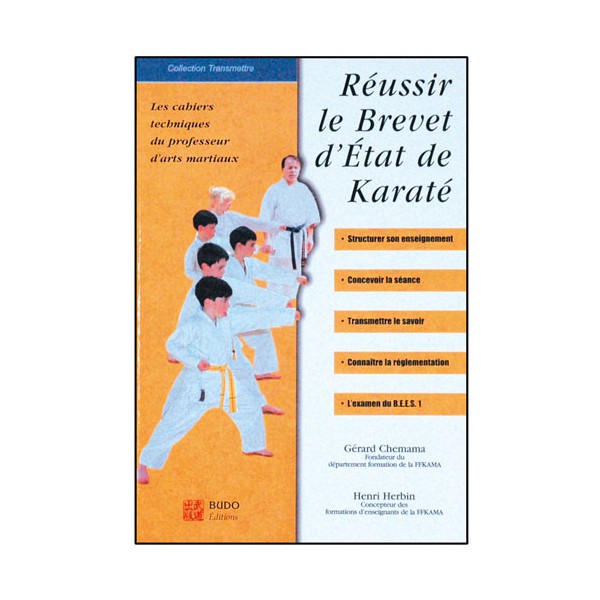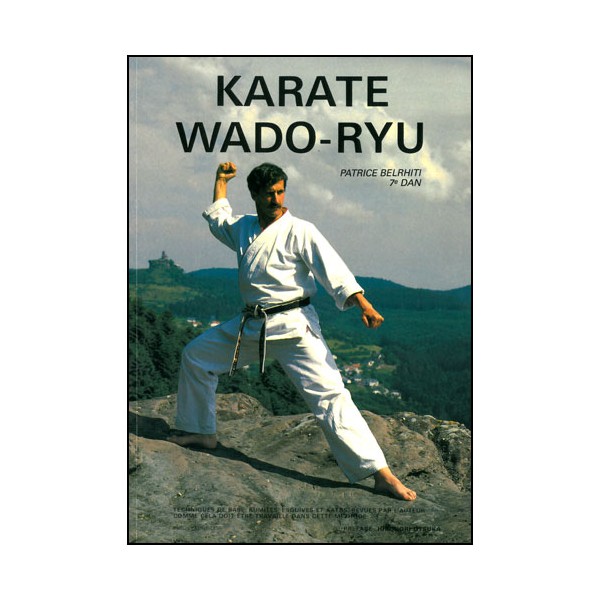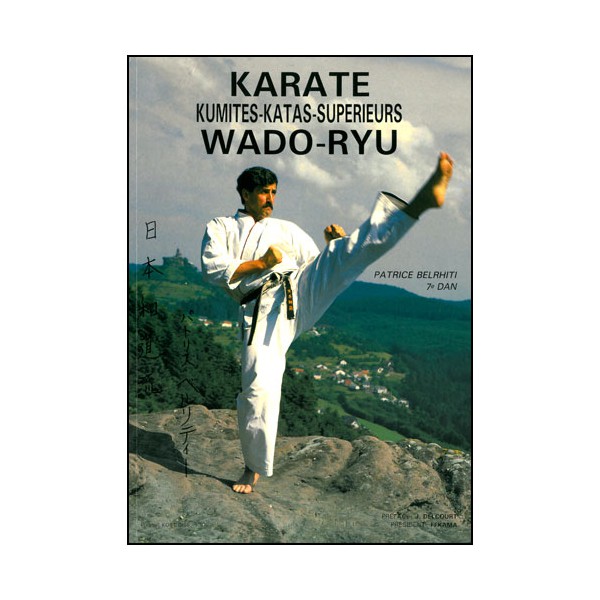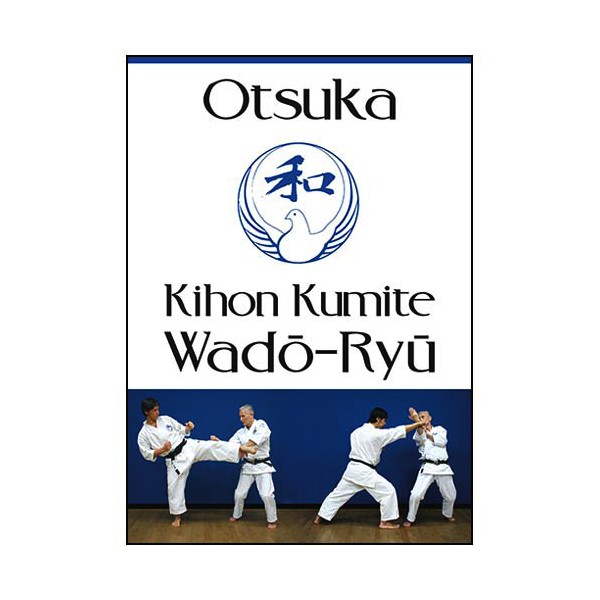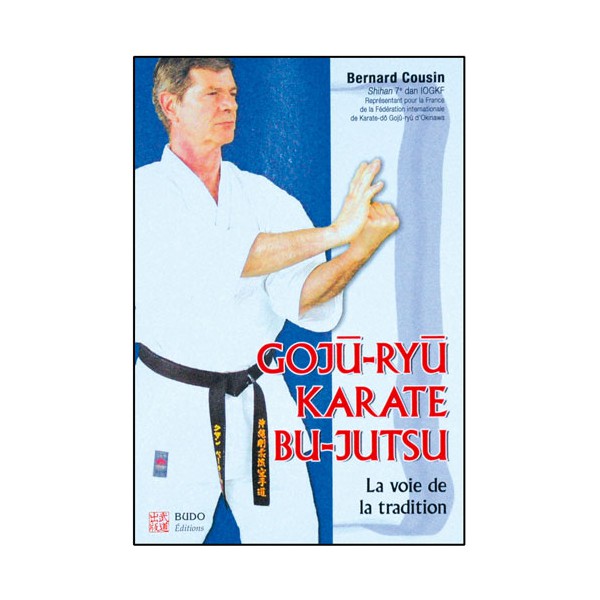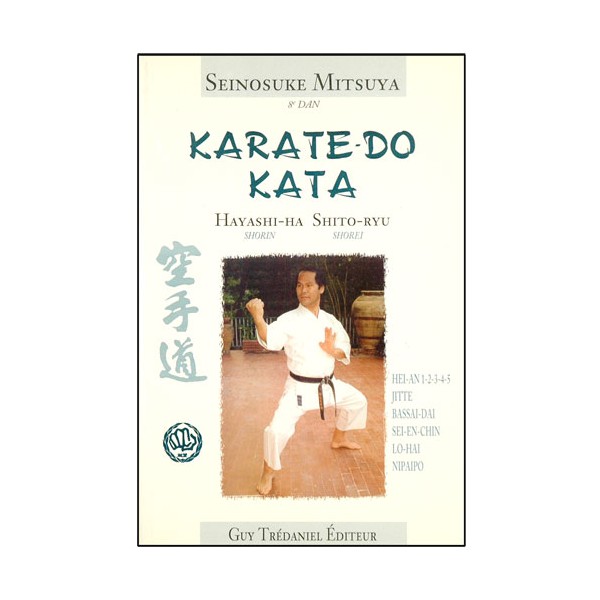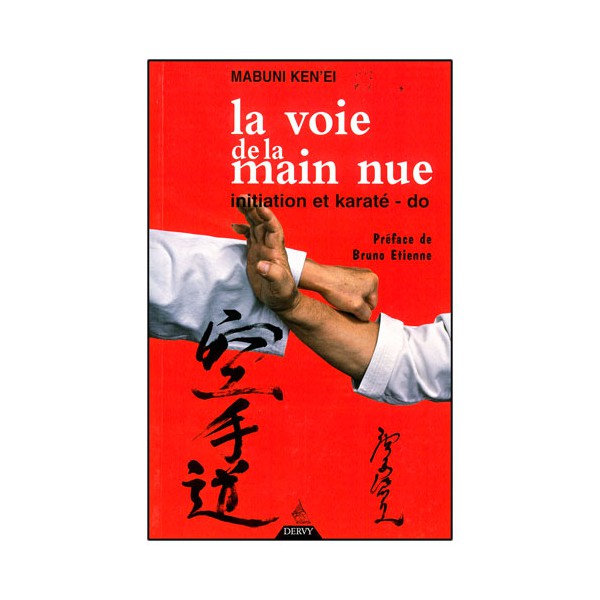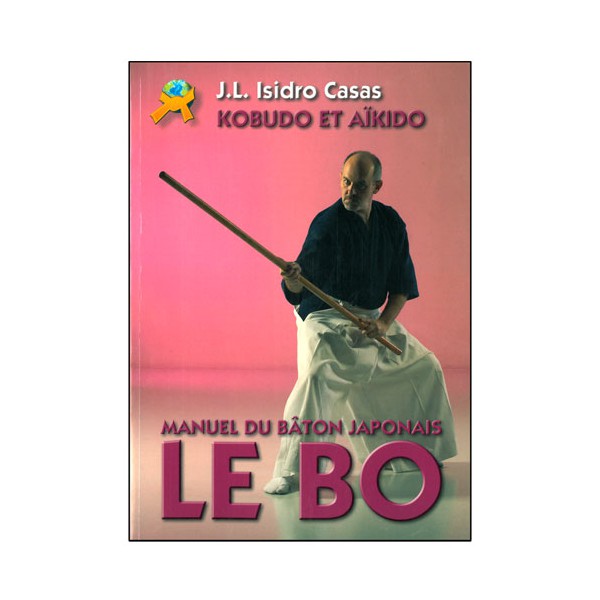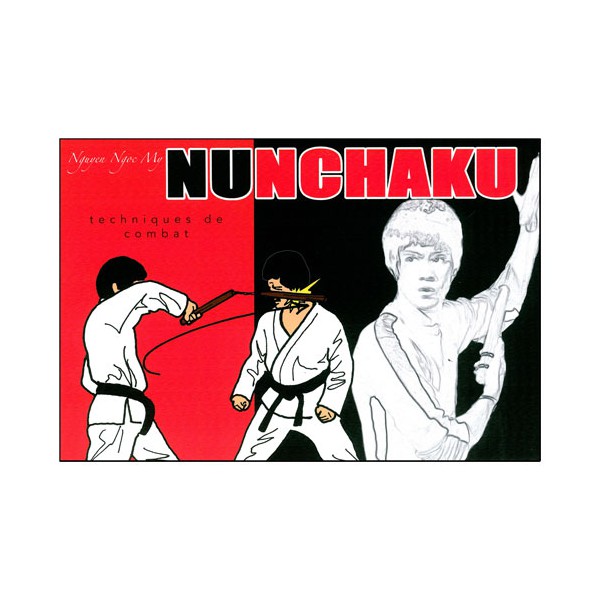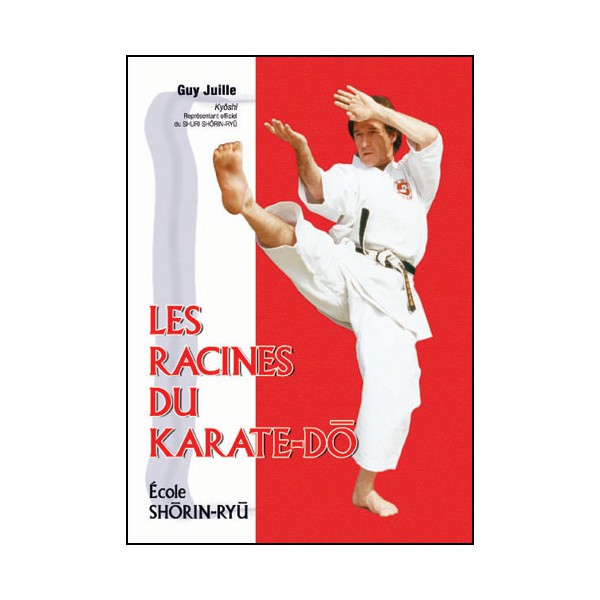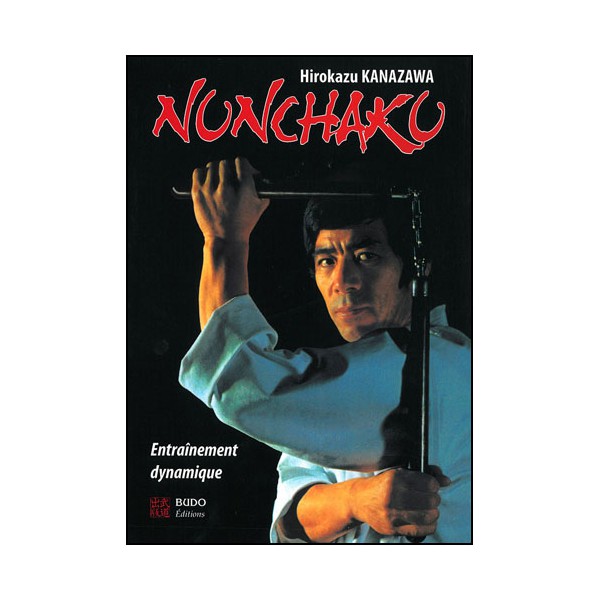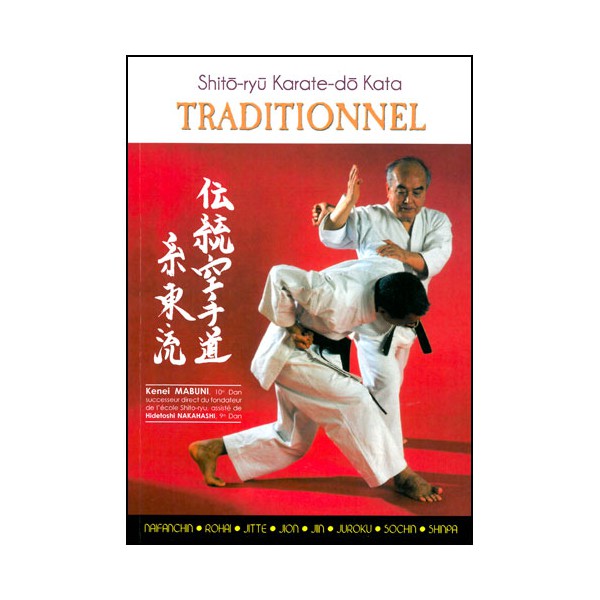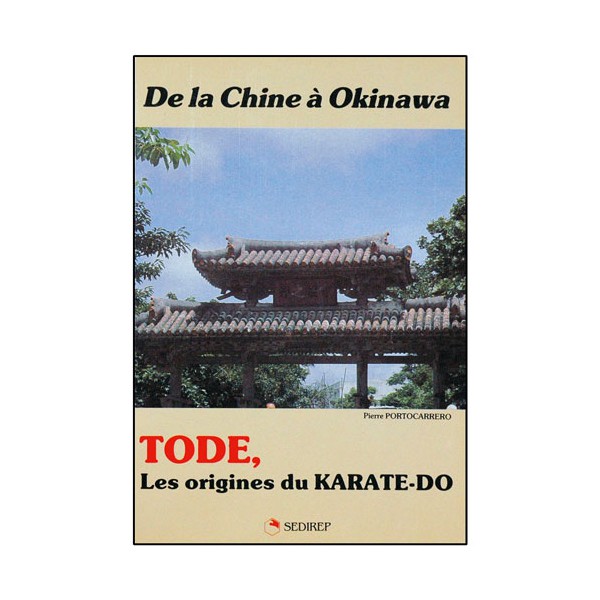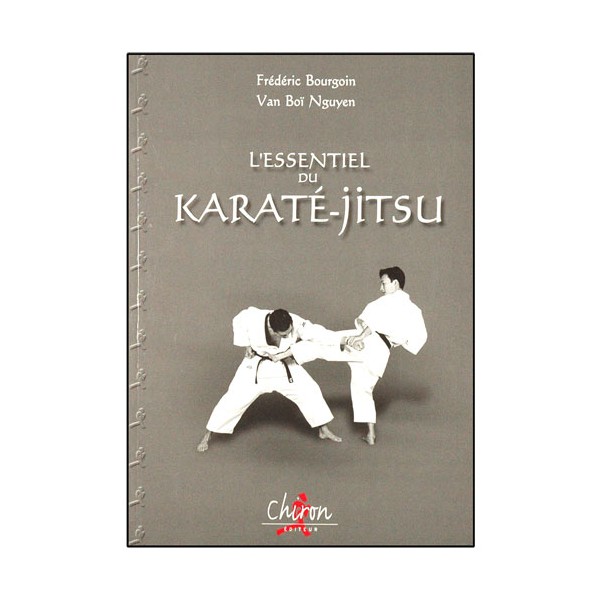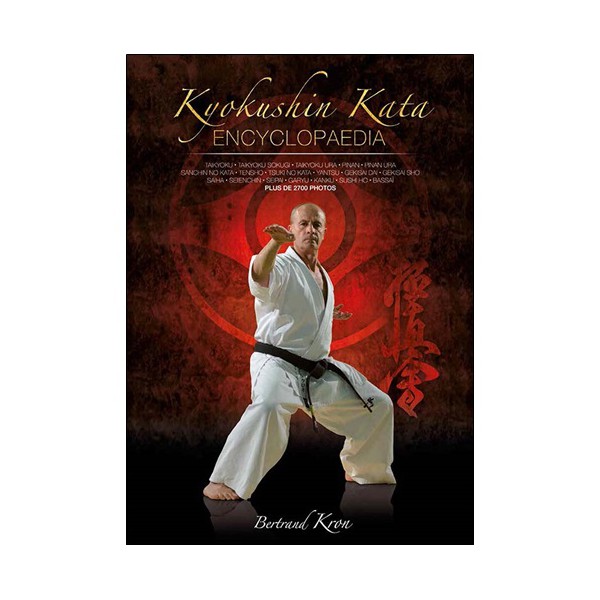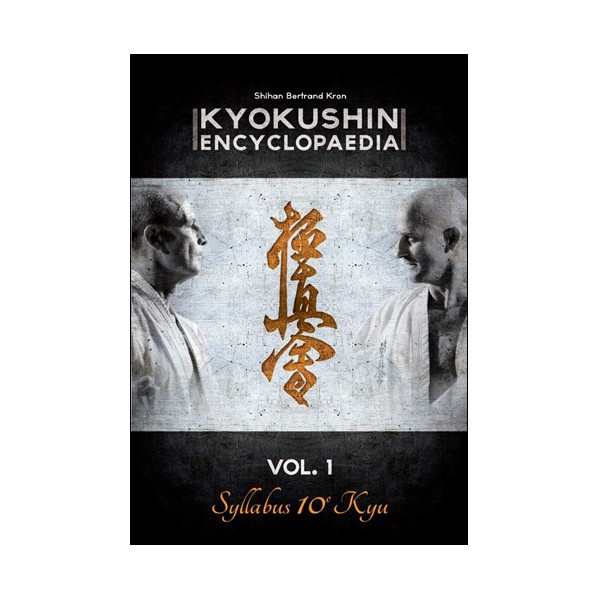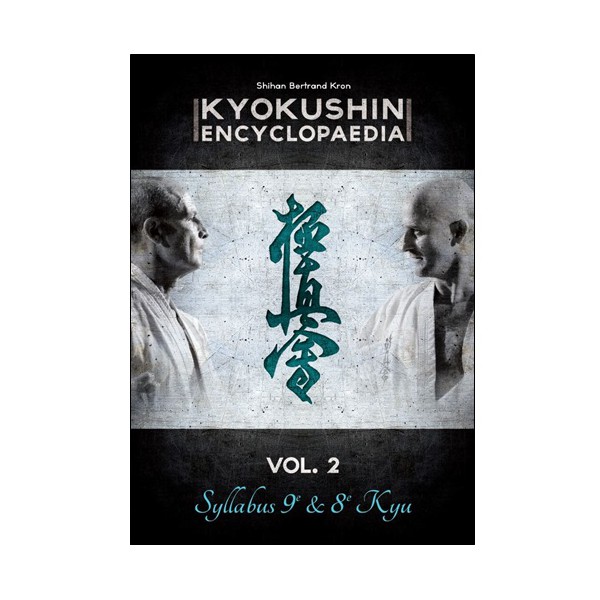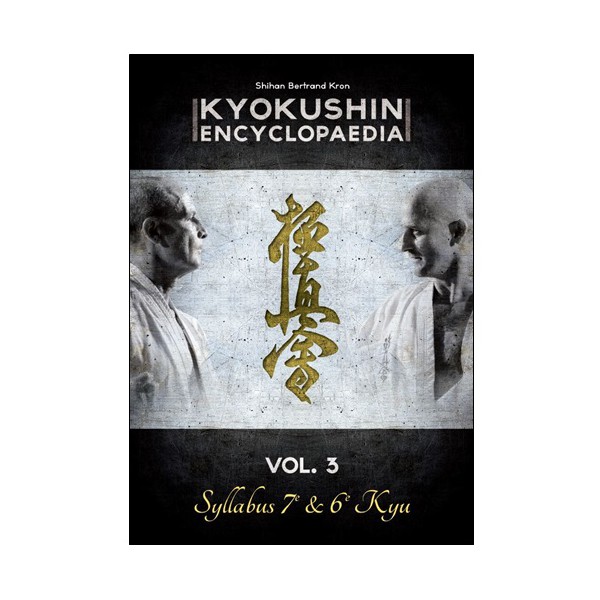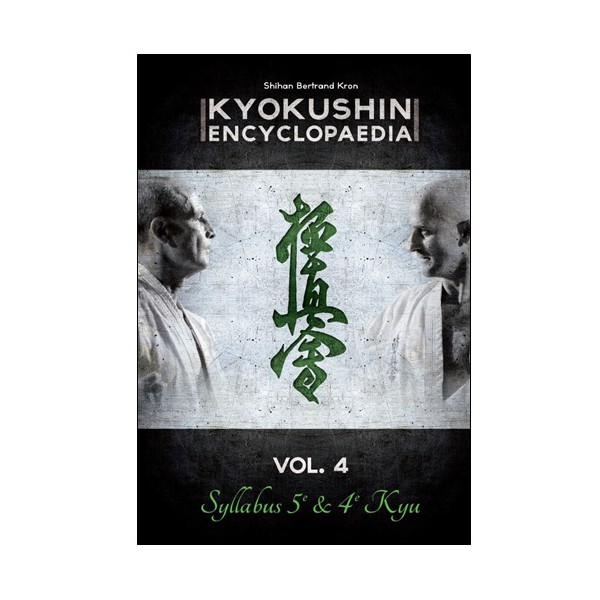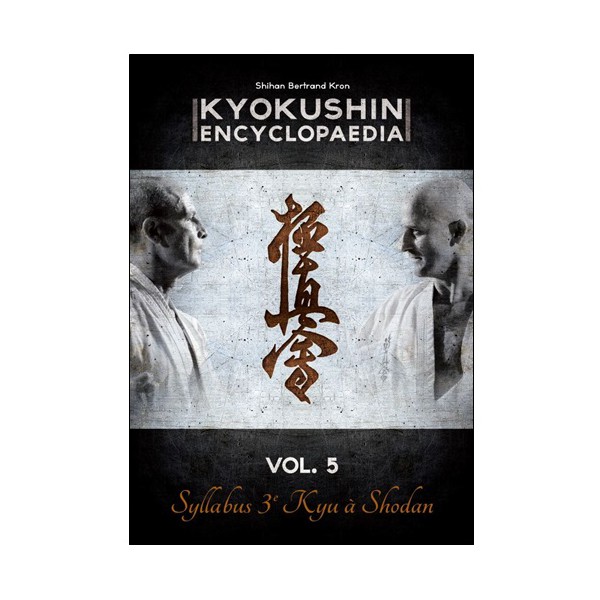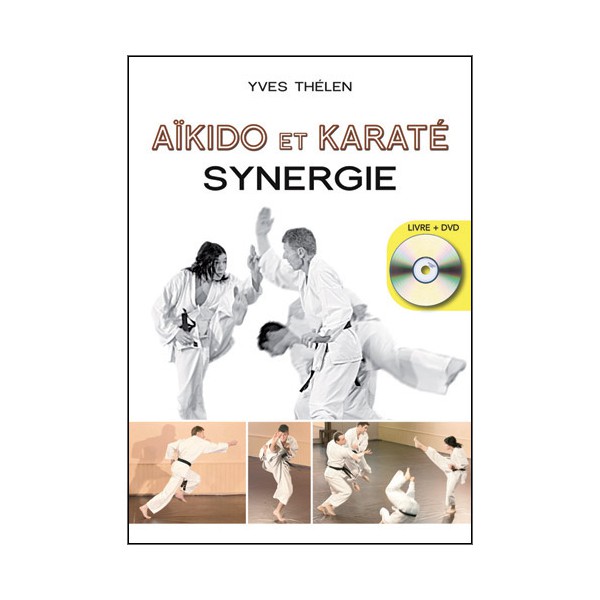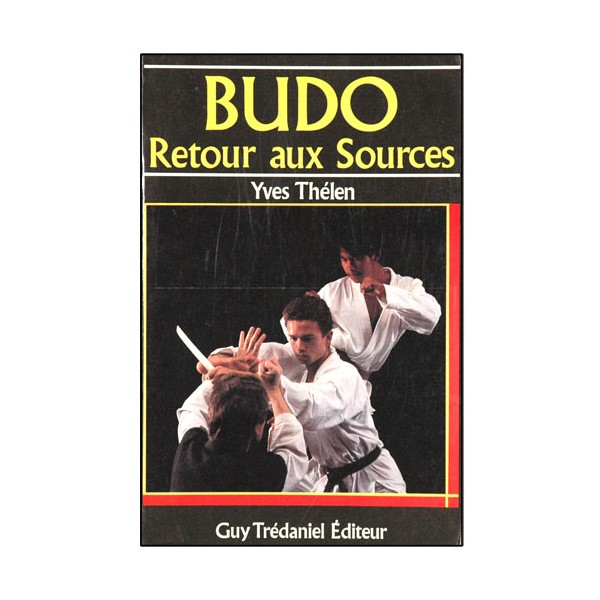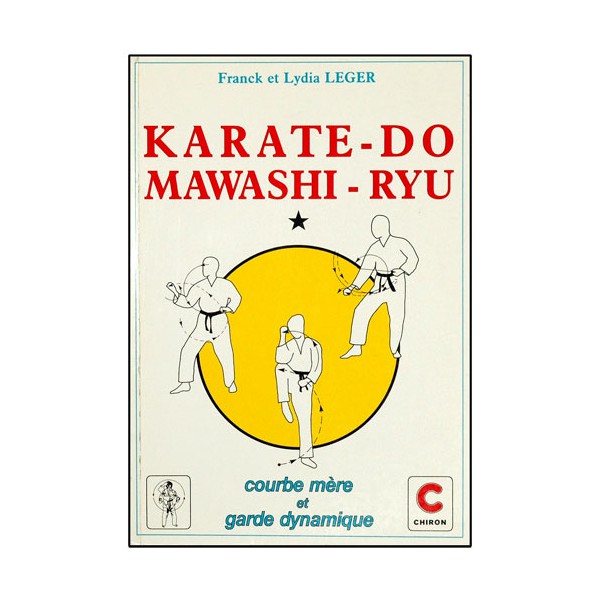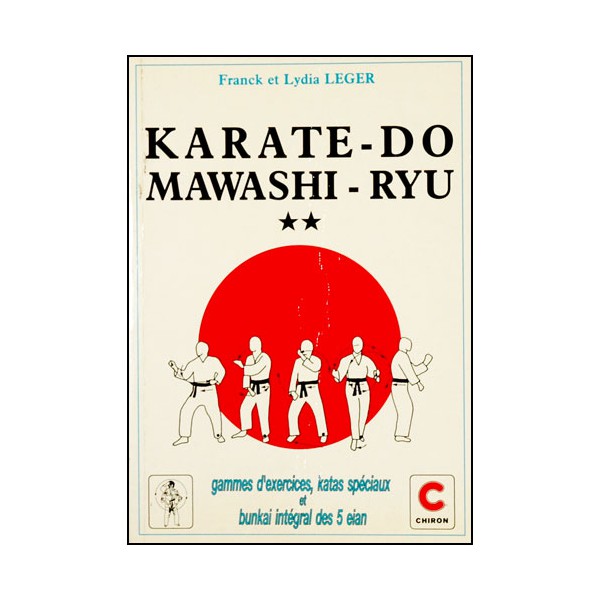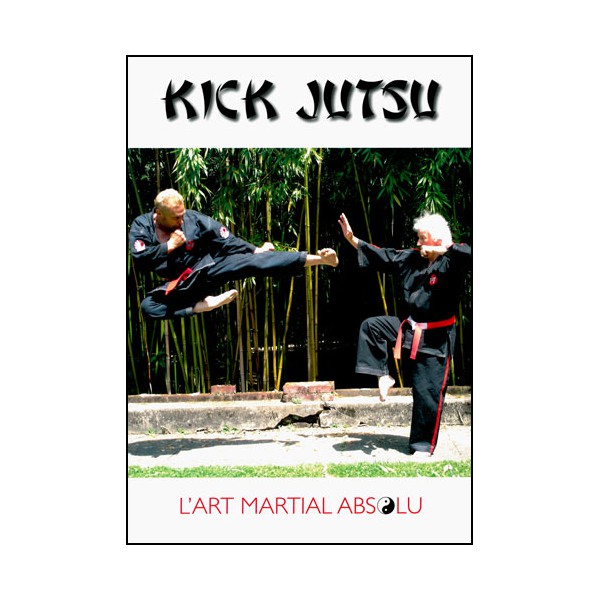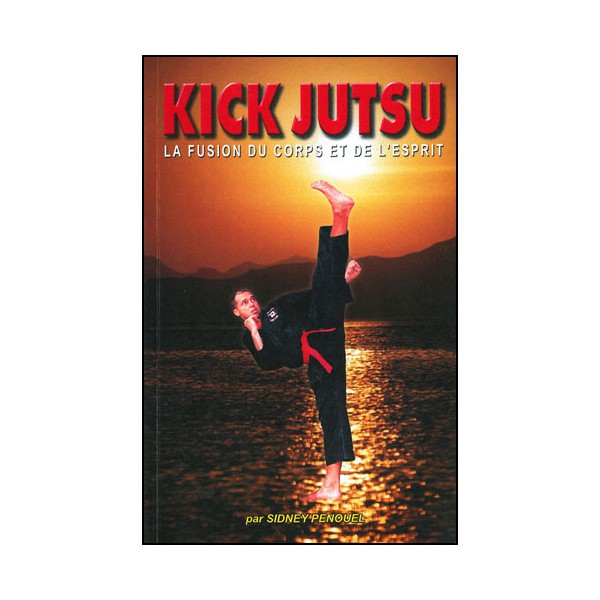Panier
Aucun produit
Sur les traces d'Itosu, de Chibana et de Miyahira. Le shurite moderne sans filtre - Jean-Charles Juster
- Donnez votre avis
Plus d'informations
Ce livre constitue le troisième de la série consacrée à la traduction de textes capitaux des arts martiaux okinawanais. Centré sur Itosu Ankô, Chibana Chôshin et Miyahira Katsuya, soit le shurite moderne, ce recueil de textes écrits par ces derniers présente des éléments biographiques, techniques et historiques nouveaux. Renommés pour leur action au cours du siècles précédents, ces trois auteurs, et experts, ne sont paradoxalement pas connus pour leurs écrits, alors qu’ils sont la porte d’entrée à des savoirs précieux pour comprendre l’école Kobayashi (ou Shôrin) et pour saisir comment et pourquoi le karate a emprunté le chemin qui l’a conduit à prendre la forme qu’il a de nos jours. Avec au sommaires sept textes : Les Dix points sur la bonne attitude pour la pratique du tôde (Tôde kokoroe jikkajô) [1908] ; d’Itosu Ankô/ Récit sur la bravoure d’Itosu (Itosu buyû-den) [1915] de Yabu Kentsû/ Le karatedô (Karatedô) [1953] de Chibana Chôshin ; Sur le karatedô (Karatedô ni tsuite) [1958] Chibana Chôshin ; Le karate et moi (Karate to watashi) [1966] Chibana Chôshin/ Histoire et particularités de l’école Kobayashi (Kobayashi-ryû no ayumi to sono tokuchô) [1973] de Miyahira Katsuya ; Mon voyage dans le karate brésilien Burajiru karate no tabi [1978] de Miyahira Katsuya Présentation de 4e de couverture : Itosu, Chibana, Miyahira, trois hommes, trois noms restés longtemps confinés aux milieux initiés à Okinawa ou bien connus de rares adeptes occidentaux en lien direct avec les arts martiaux de cette île. Itosu Ankô, «le père du karate moderne» gagne en reconnaissance à mesure que les pratiquants s’ouvrent aux origines de leur art de la «main vide», autrefois «main de Chine». Son écrit phare, dit Les Dix préceptes d’Itosu, est un texte crucial pour saisir les tenants et aboutissants du karate du XXe siècle. Il bénéficie ici d’un travail de traduction poussée et de commentaires qui permettent de capter toute sa signification. Chibana Chôshin et Miyahira Katsuya s’inscrivent dans la lignée la plus directe d’Itosu et de ses idées novatrices. Des articles composés de leur main, traduits ici pour la première fois en français, nous aident à mieux appréhender l’évolution du karate au cours du siècle dernier. En tout sont réunis dans le présent livre sept textes riches traduits et commentés, à la portée aussi bien technique qu’historique, offrant un regard nouveau sur leurs auteurs, et au-delà, sur le sens de la pratique.
Jean-Charles Juster est né à Paris en 1978.
Fils d’un acupuncteur traditionnel, il passe son enfance entre les traités de médecines chinoises et les classiques chinois, tandis que son père lui apprend quelques points de pression qui font naître en lui un intérêt pour le corps et ses mécanismes.
Intéressé depuis toujours par le Japon, il entre aux Langues'O en 1997, après des études littéraires où il a la chance d’étudier le japonais en 3e langue vivante.
Après une licence de langue, de littérature et de civilisation japonaises, il entame un cycle de maîtrise en 2001.
L'année suivante, il intègre l'école doctorale des Langues'O sous la direction du professeur François Macé, qui dirigera dès lors tous ses travaux de recherche. Influencé par la vision large de la civilisation japonaise de son directeur de recherche, il commence, en pionnier, à s’intéresser à Okinawa, et choisi d’étudier sa culture à travers ses danses.
Le mémoire de son DEA était intitulé Introduction aux danses des Ryükyü.
En 2002, il s'inscrit en ethnologie à l'Université de Paris X Nanterre.
En 2003, il commence sa thèse de doctorat (soutenue en 2007) intitulée : Les rapports entre les danses et les arts martiaux d'Okinawa, de la forme à l'identité
En 2005, il part pour Okinawa, à l'Université d'Okinawa des arts établie à Shuri, afin d'entamer un cycle de master de deux ans. Il a durant cette période rencontré de nombreux spécialistes des arts scéniques okinawanais.
C'est également à cette époque qu'il met en pratique les théories de l'ethno-choréologie apprises à Nanterre, notamment dans le cadre de ses recherches de terrain pour ses travaux doctoraux.
Il commence alors à être introduit dans certaines salles et écoles, comme le Kyûdôkan des Higa, l’Okinawa kenpô de Yamashiro Yoshitomo, le Bunbukan de Nakamoto Masahiro, ou le dojo de Hokama Tetsuhiro.
En 2009, il devient membre du Centre de recherche sur la culture okinawanaise de l'Université Hôsei à Tokyo. Depuis cette année, il effectue des séjours annuels de recherche à Okinawa, principalement dans les milieux des arts scéniques et des arts martiaux.
En 2014, il co-publie le premier livre dédié à Okinawa et à sa culture en langue française : Un clan d'Okinawa Les Tamanaha de Shuri.
Partant du constat qu'Okinawa est très mal connu en Occident, ou l'est pour de mauvaises raisons, JC Juster a pour but de proposer des écrits simples, mais aucunement simplistes, sur les différents éléments émanant de la culture et de la société des ces îles.